Abolissons le travail ! Jaggernaut n°3 / edito par Clement Homs : "Rien ne sert d'être vivant s'il faut que l'on travaille".
Le n° 3 Abolissons le travail ! de la revue Jaggernaut- Crise et critique de la société capitaliste-patriarcale sera disponible dans toutes les librairies en France, Belgique et Suisse à partir d'aujourd'hui vendredi 13 novembre 2020. Ci-dessous l'éditorial de ce numéro.
Rien ne sert d’être vivant, s’il faut que l’on travaille.
Non, le travail n’est pas une nécessité naturelle, éternelle, qui aurait toujours existé, c’est une forme sociale négative et destructrice de l’agir, dont l’avènement est concomitant de celui du capitalisme et qui fait abstraction de tous les contenus concrets des activités hétérogènes pour mieux les réduire à la forme vide de contenu d’une simple dépense abstraite d’énergie humaine – le travail abstrait.
Non, le travail vivant producteur de marchandises n’a fondamentalement aucun rapport avec le métabolisme avec la nature (depuis quand la finalité du capitalisme est-elle la satisfaction des besoins ?!), le travail vivant n’est que l’expression « vivante » du travail mort – l’argent ‒ devenu fin en soi. Le travail vivant mis en boucle avec lui-même est le mouvement tautologique de reproduction et d’autoréflexion de l’argent qui ne devient capital que sous cette forme, comme transformation d’un quantum de travail mort et abstrait (la valeur) en un autre quantum plus grand de travail mort et abstrait (la survaleur). Le travail vivant est la manifestation concrète, de chair et d’os, de l’universalité abstraite du travail.
Non, les êtres humains dans les sociétés non-modernes n’agissent pas sur la « nature » aux fins de satisfaire des besoins positifs tels que se nourrir ou se vêtir, mais pour sceller des relations d’« alliance » avec des divinités imaginaires qu’ils mettent à l’origine de leurs propres rapports sociaux.
Non, le travail concret, dans ses gestes et ses savoir-faire n’est pas l’activité transformant en tout lieu et de tout temps, en toute innocence et neutralité, la « matière » pour lui donner une autre forme, mais la manière matérielle spécifique dont le travail abstrait en se matérialisant dans ton corps, ta parole, tes « savoir-faire » et tes gestes opère sa mainmise sur la « matière » naturelle ou sociale. Le travail concret est de prime abord rien d’autre que le précipité sensible-empirique d’un processus d’abstraction qui le transcende.
Non, le travail dans le procès de production ne « vaut » pas pour ce qu’il paraît être, à savoir un procès concret de fabrication de meubles, de médicaments, de barquettes de poulet basquaise, de fers à friser les cheveux, de jouets Mattel ou Playmobil, etc., il vaut comme dépense de force de travail abstraite en général, comme « gelée de travail abstrait » (Marx) qu’il convient d’optimiser par une meilleure gestion, afin de le représenter sous la forme de davantage d’argent. Les marchandises qui se taillent dans le matériel humain les « besoins » qui leur correspondent, ne sont toujours que l’enveloppe d’étape, quelconque et transitoire, sous laquelle apparaît la métamorphose de l’argent.
Non, le travail n’est pas aliéné, il est l’aliénation même.
Non, tu ne travailles pas pour toi, tu travailles à produire des marchandises – biens ou services ‒ pour obtenir un salaire afin d’acheter des marchandises que d’autres auront fabriquées, et ce parce que tu es déjà à tout instant le support concret et vivant, exploité et interchangeable, de l’automouvement de l’argent, alias le rapport-capital.
Non, l’utilité, la valeur d’usage de cette marque de frigo, de cet ordinateur portable, de ce pack de bières, de ce livre que tu tiens entre les mains, n’est pas une détermination ontologique-transhistorique plantée dans l’immaculée blancheur de sa forme sociale prétendument neutre, elle est la manière toujours spécifique dont l’abstraction réelle de la valeur s’empare des choses, en soi non abstraites, pour en faire des marchandises.
Non, le produit concret, sensible, le corps même d’une marchandise n’est pas un bien neutre et innocent qui aurait pu exister depuis la nuit des temps, il n’est que l’expression concrète et transitoire de l’abstraction de l’argent.
Non, le goût de ce sucre de betterave néonicotinoïdé ou de cette tomate modifiée génétiquement, de cette charcuterie aux sels nitrités, de ces hochets et anneaux de bébé chimifiés, de ce steak de bœuf gonflé aux anabolisants, de ce soda saturé de sucre, n’est pas le sensible neutre, innocent et naturel, mais le sensible-abstrait déjà modifié intérieurement pour être le « support » du plus profitable automouvement de l’argent qui soit.
Non, la durée de vie de cette « machine à pain », de cette chaise en plastique, de cet écran télé que l’on ne veut plus regarder, n’est pas celle de la dégradation naturelle de leurs matériaux, mais celle de leur obsolescence toute programmée afin de raccourcir le cycle d’incarnation de l’automouvement de l’argent dans une nouvelle flopée de marchandises jetées sur le marché.
Non, ceci n’est toujours pas une pipe, c’est une chose sociale pleine de subtilités métaphysiques, c’est du travail abstrait.
Non, ceci ce ne sont pas des vaches, qui, dans leur univers concentrationnaire de stabulation et de nourriture artificialisée, ne regardent de toute façon plus passer les trains, c’est de l’argent sur pattes perfusé aux tourteaux de soja qui ne demande qu’à s’accroître.
Non, ceci n’est pas une tranche de jambon, c’est l’automouvement de l’argent qui s’est concrètement incarné d’une façon aveugle et terrifiante dans un animal vivant qui sent, éprouve, s’adapte, agit.
Non, ceci n’est pas un missile de Nexter industrie, c’est de l’argent qui s’est investi dans un contenu de production quelconque pour se métamorphoser en davantage d’argent au travers des corps des enfants éventrés, des habitants terrorisés et des ruines fumantes de Damas, d’Alep ou de Sanaa.
Non, ceci n’est pas un poirier qui produit des poires, c’est un arbre capitalistiquement transformé qui produit de l’argent comme le poirier pouvait jadis produire des poires.
Non, la valeur d’usage ne définit pas un au-delà de l’économie politique, la valeur d’usage n’est toujours que l’horizon aberrant de la valeur marchande.
Non, tu n’es pas un être de besoins, Non tu n’es pas voué à les satisfaire, Non tu n’es pas une force de travail.
Une saison dans l’enfer du travail
Recul de l’âge de la retraite, lois-travail à répétition, ubérisation du travail, mal-être au travail et sentiment d’une perte du sens des métiers, « boulots à la con » dénoncés publiquement, développement massif des troubles musculosquelettiques, explosion des pathologies de surcharge de travail comme le burn out ou la mort subite (le karôshi) de cadres ou d’employés par arrêt cardiaque ou AVC, multiplication des suicides sur les lieux de travail, harcèlement moral et sexuel, diatribes contre l’open space, télétravail sous Covid-19, débat sur la possibilité d’un revenu universel, dénonciation de la « charge mentale » des femmes ou de la répartition du « travail domestique », etc., ces dernières années, jamais les plaintes à propos du travail n’auront été autant entendues et jamais le travail n’aura été à ce point ancré dans les mœurs que nous ne voyons toujours pas comment vivre sans lui.
La façon dont le rapport-capital en crise traite sa composante qu’est le travail, crée pourtant a priori des conditions favorables à la critique du travail par lui-même. Deux ou trois milliards de « travailleurs sans travail », ces non-rentables jetés partiellement ou complètement en dehors du mode de production et de vie capitaliste, n’ont pas constitué pour autant une force révolutionnaire abolissant le rapport-capital et son fétiche-travail. S’il existe bel et bien un mécontentement croissant vis-à-vis de l’absence de travail, des formes et des conditions de travail ou encore de sa rémunération, dans la forme de vie capitaliste laissée intacte, le travail s’impose à tout le monde et n’intéresse les débats qu’en termes de modalités sectorielles, d’accommodements personnels ou de survie bien comprise dans ses marges et interstices. Hors du travail et de sa contrainte, existe-t-on vraiment ? Du dedans, du ventre de la forme de vie sociale moderne, le travail n’est-il pas inhérent à la « condition humaine » ? La forme de vie sociale capitaliste où les individus n’existent qu’en se rapportant structurellement les uns aux autres au travers du travail et de ses formes de représentation, la valeur, l’argent et les marchandises qu’ils produisent et consomment, constitue une « cage d’acier » (Max Weber) qui empêche d’identifier la cause matricielle des souffrances sociales contemporaines. Cette façon largement inconsciente de se cohérer socialement, constitue un piège qui non seulement enferme à la fois nos corps et nos esprits, mais qui s’est refermée sur la conscience critique elle-même, même lorsqu’elle est oppositionnelle ou révolutionnaire. L’anticapitalisme tronqué s’installe ici sur le trône de la conscience critique. Aucune autre réalité moderne n’est autant restée obscure à la pensée éclairée d’une société qui s’est paradoxalement toujours dite rationnelle et consciente d’elle-même. Le travail, en tant que tel, reste dans l’angle mort des luttes sociales et sociétales et un mouvement social d’abolition de la forme de vie sociale organisée autour du travail et de ses représentations se fait toujours attendre.
La gauche de tout horizon n’a pas davantage dérogé à la règle de la méprise moderne qui recouvre les fondements de la vie moderne. Dans les limites d’une forme de vie sociale finalement jamais remise en cause, l’ambition de « Changer la vie » devait se transformer en toute logique en la formule assumée de Léon Blum : « Gérer loyalement le capitalisme ». Ainsi, les deux mouvements des « forces de gauche » qui devaient s’opposer respectivement à la première contradiction immanente du capitalisme (celle entre capital et travail) et à la seconde (celle entre capital et « nature »), ne pouvaient que chercher à aménager les murs de cet enfermement : créer un capitalisme à visage humain. Aujourd’hui, en ce début du XXIe siècle, la crise des fondements du capitalisme est tout autant la crise de cet anticapitalisme tronqué. La gauche n’a pas encore franchi le Rubicon d’un changement radical de représentation de ce qu’est le « capitalisme », et en conséquence, d’un nouveau projet émancipateur. Elle n’a toujours pas tranché le nœud gordien que constitue la totalité sociale capitaliste. Elle ne lève toujours jambes, barricades et mégaphones que pour mieux déifier le travail et ses représentations, affirmer leur prétendu caractère indépassable. Le travail, l’argent et une vie à acheter et vendre des marchandises, à se vendre comme marchandise sur le marché du travail, sont toujours autant perçus comme l’air que l’on respire ou l’eau que l’on boit, le vol des oiseaux qui parcourent le ciel : cette forme de cohésion sociale où se trouve embarquée la reproduction de nos vies individuelles, a toujours existé et existera jusqu’à la nuit des temps ! À quoi bon déchirer le rideau du Saint des Saints d’une modernité productrice de marchandises si elle-même est la nature humaine en personne ? Partout le mécontentement reste bridé par ce plafond de verre du flou définitionnel autour du travail, de l’argent, de la valeur et des marchandises, leur légende et leur naturalisation, qui vont avec celles de l’économie et de l’économique en tant que tels.
Le sens commun du terme « travail » qui est spontanément accepté, le désigne comme toute forme d’action de l’homme sur la nature, couplée à ses résultats. L’universalité prêtée à cette fonction l’associe étroitement à la nature, et relève quasiment de l’ordre du biologique. Le travail dans sa définition serait l’ensemble des activités touchant à la production de biens matériels ou à la subsistance. Rien de moins… Au mieux, le travail n’est toujours dénoncé que sous la forme du « travail forcé ». Depuis le XVIIIe siècle, on critique alors celui-ci au nom du « travail libre » ; ainsi le 22 septembre dernier, la Chambre américaine des représentants a adopté un projet de loi visant à interdire aux États-Unis la plupart des importations en provenance de la région chinoise du Xinjiang, afin de bloquer l’importation de produits issus des Ouïghours [1]. Il échappe pourtant encore à la fausseté bourgeoise que ces 380 « camps » ‒ des « centres de formation professionnelle » selon la propagande officielle ‒ ne sont pourtant rien d’autre, sous la forme d’un retard à l’allumage, que le propre passé capitaliste fait de workhouses et de « camps de travail » des pays de chez Freedom et Democracy.
Le travail a toutefois perdu son aura ces deux dernières décennies au moins dans certains discours militants ou intellectuels. Sa Majesté est désormais ouvertement décriée, vilipendée, évitée voire détestée. La jeunesse se pose toujours les mêmes questions face à son futur devenir de travailleurs (plus ou moins) rentables. Ce qui relève d’une critique du simple contenu, des conditions et de la forme concrète prise par tel ou tel travail ‒ ce que nous appellerons une critique phénoménologique du travail ‒, n’a certes jamais cessé d’exister durant toute la modernité. Il s’agit d’une analyse critique empirique, historique, éthique et morale, d’objets précis, perçus empiriquement, partant du principe que le travail en tant que tel, comme forme sociale prise par l’agir, n’est pas problématique. Mais en critiquant les seules conditions concrètes, cette analyse reste pieds et poings liés dans le mode de pensée positiviste. Seuls des phénomènes particuliers relevant du travail peuvent être l’objet de critiques, mais jamais le « travail » en tant que tel, dans son existence comme forme sociale et dans son rôle induit par sa double nature, abstraite et concrète. On ne se réfère plus qu’à un « agir » déterminé dans des catégories occultées, irréfléchies et donc non critiquées. Comme l’a fait remarquer Alastair Hemmens, « on a gaspillé beaucoup d’encre en critiquant ou décrivant la phénoménologie ou la sociologie du travail : la division du travail, ses conditions, sa rémunération, qui le fait, pourquoi dans un sens immédiat le fait-on, comment il est organisé, comment il a évolué, ses technologies, son injustice, ce que l’on ressent en le faisant, comment les producteurs sont aliénés par la dépossession de leurs produits et de leur propre activité, etc. » [2]. La critique du seul régime juridique du salariat au nom du travail libre, autonome, indépendant ou autogéré, voire au nom du « contrôle ouvrier », fait partie de cette critique tronquée du travail qui reste aveugle au fait que le salariat n’est qu’une des formes phénoménologiques particulières prise par le travail. Dans une telle perspective, la critique phénoménologique du travail et la plainte à propos du « turbin » sont au moins aussi anciennes que sa naissance. Un poco, ma non troppo, car nous n’aimons toujours le travail qu’à certaines conditions.
Chaque restructuration de l’appareil de production, sous la poussée d’une nouvelle hausse de productivité, a conduit à ce genre de critique phénoménologique de chacun des contenus des nouvelles formes prises par le travail. Pensons aux États-Unis, à la critique du salariat faite par les petits propriétaires et producteurs de marchandises au début du XIXe siècle et dont Christopher Lasch a pu faire l’apologie sans un véritable concept de « capitalisme » [3], aux Luddites en Angleterre comme en Espagne s’opposant au début du XIXe siècle à l’introduction des machines ou à la critique des chaînes de production fordistes dans Les Temps modernes de Charlie Chaplin comme sur le terrain des luttes sociales, etc. Aujourd’hui l’ubérisation du travail, c’est-à-dire cette forme non salariée – quasi proto-industrielle ‒ du travailleur 2.0, suscite autant de critiques et d’interrogations. Les luttes autour du travail de nettoyage dans l’hôtellerie française tout autant. De manière plus générale, au travers du concept de flux tendu, le principe du flux productif – la lean production – s’est généralisé depuis les années 1980 à l’ensemble de la production marchande des biens et des services et s’est accompagné d’un nouveau régime de mobilisation des salariés. Ce « modèle néo-fordien » qualifié également de « taylorisme flexible », a façonné dans le domaine de la subjectivation un « homme nouveau » nécessaire à cette restructuration du côté concret du travail.
Le capitalisme a désormais besoin de salariés capables d’initiatives, de prises de responsabilités, non plus fondamentalement de « qualifications » comme au temps fordiste mais de « compétences », c’est-à-dire d’être en capacité de faire face en permanence aux imprévus objectivés du capitalisme de crise [4] et de ses marchés mondiaux. Un « nouvel esprit du capitalisme » a ouvert une place apparente à la responsabilisation des salariés et à l’extension de leur autonomie, ce dont témoigne depuis les années 1990 la langue même de l’entreprise quand elle ne parle plus de simples salariés, mais de « collaborateurs ». On ne veut pas, en apparence, de simples « exécutants » mais des travailleurs « pro-actifs » ‒ un élément de langage majeur de la dernière décennie ‒, c’est-à-dire que la restructuration post-fordiste de l’appareil de production a impliqué, fait observer Norbert Trenkle, que « les fonctions de commandement du capital furent en partie intégrées dans les différentes activités de travail, et que de cette façon, la contradiction entre travail et capital fut transférée directement à l’intérieur des individus » [5]. Cette exigence, finalement, consiste à faire immédiatement intérioriser aux salariés, sous la forme d’une injonction permanente à la malléabilité, la structure coercitive et objective des exigences que réclame désormais la valorisation de la valeur à son « matériel humain ». Le capitalisme de crise façonne un salarié de crise à son image, réduit concrètement à n’être plus, sous sa propre responsabilité personnelle et son initiative, que le porteur docile et auto-soumis de l’automouvement de l’argent.
Cependant, dans le même temps, ce « nouvel esprit du capitalisme » et sa conjoncture de crise structurelle fabriquent un « homme nouveau » traversé par des exigences contradictoires dans l’exercice de ce même travail. On peut ici suivre les thèses du sociologue Jean-Pierre Durand en les modifiant quelque peu [6]. D’une part, cette autonomie, cette responsabilisation du salarié, cette réalisation de soi par la prise d’initiative, cette mise en œuvre d’un ethos pro-actif et d’une « compétence », sont toujours bornées par un cadre organisationnel ‒ le lean management ‒ qui contrôle et encadre cette autonomie, notamment à travers la façon dont on s’assure des résultats quantitatifs et qualitatifs du travail des salariés à partir des outils de reporting, d’évaluation, d’entretien individualisé, de logiciels mouchards pour poste en télétravail, etc. En ce sens, la fonction de commandement du capital sur ce travail « responsabilisé » n’est plus que de l’ordre du contrôle et de la vérification de cette responsabilisation du salarié. On s’assure que le « collaborateur » est capable de lui-même ‒ au travers d’une auto-discipline du corps et de l’esprit qui n’est que l’envers de ce transfert apparent de responsabilité ‒, de se soumettre aux exigences de la valorisation de la valeur et tout particulièrement de la compulsion de la productivité qu’impose le cadre concurrentiel. Et au besoin, de sa mâchoire de fer, le top management lui serrera la vis. Les salariés du fordisme flexibilisé doivent désormais exécuter envers eux-mêmes la fonction sans sujet, supra-individuelle de l’automouvement de l’argent (la valorisation). Ils doivent devenir les « sujets » immédiats du « sujet automate » (Marx) – dont les figures archétypales sont aussi celles de l’auto-entrepreneur ou du travailleur-Uber. Idéalement, ils ne doivent devenir rien de plus que des « objets » du processus de valorisation, c’est-à-dire qu’ils doivent, en tant que travailleurs, en intérioriser les contraintes au plus profond de leur psyché. Ils doivent ne faire plus qu’un avec la « domination sans sujet » (Robert Kurz) qui s’abat sur eux. L’entrepreneur de soi-même, qui n’est rien d’autre que « l’exploiteur de soi-même », constitue ici la logique de la valeur pleinement réalisée dans son matériel humain : l’anthropomorphose même du capital. Mais ici, l’homme nouveau salarié, remarque Jean-Pierre Durand, est « clivé, disjoint entre l’expression de lui-même ou la réalisation de soi d’une part et, d’autre part, le cadrage de son activité par une organisation hétéronome » [7]. Il combine désir d’agir ou de faire, excité par ses propres initiatives et sa nouvelle responsabilisation, « tout en étant sans cesse bloqué dans celles-ci par une organisation et une hiérarchie qui l’estropient, mais auxquelles il voue son attachement » [8]. Et il faut aller plus loin ici que Durand et son marxisme traditionnel : son désir d’autonomie et de devenir pleinement sujet de son travail, est « bloqué » par le statut d’objet immédiat du procès de valorisation qu’il devient en exécutant sur lui-même, sans autre médiation de commandement que sa « propre » volonté, les exigences coercitives et sacrificielles.
Sur ce plan, la critique phénoménologique du travail se restructure. Le passage des années 1990 aux années 2000 marqué par le remplacement du débat sur la « fin du travail » par celui de « la souffrance au travail », s’explique fondamentalement par ce clivage du travailleur du fordisme flexibilisé. Les nouvelles pathologies du travail vont avec les nouvelles formes de destructivité que les individus s’infligent à eux-mêmes et infligent aux autres – suicides au travail, tueurs de masse, etc. Cette « souffrance au travail » correspond également au processus d’individualisation postmoderne et à ses identités flexibles, où si l’on peut se plaindre de tel ou te contenu pris par le travail, c’est également parce que nous sommes sommés tout au long de la vie de passer continuellement d’un travail à un autre, à la vitesse même du renouvellement des marchandises, de la spatialisation et des procédés changeants de leur production et des nouvelles babioles mises sur le marché.
C’est à nouveau moins le travail en tant que tel, que le contenu et les conditions du travail qui sont incriminés dans cette plainte. Témoins de la restructuration de cette critique phénoménologique du travail, les succès de librairie ou de salles de cinéma que furent Bonjour Paresse de Corinne Maier, Attention danger travail de Pierre Carles, la bande dessinée Le travail m’a tué de Arnaud Delalande, Grégory Mardon et Hubert Prolongeau, les succès encore des ouvrages de David Graeber, Bullshit Jobs, et de Julien Brygo et Olivier Cyran, Boulots de merdes ! dont le sous-titre exprime un anticapitalisme tronqué : Du cireur au tradeur, enquête sur l’utilité et la nuisance sociales des métiers. Cette souffrance au travail se veut aussi justifiée au nom d’une revalorisation du travail et des gestes et savoirs des métiers. On pense à l’ouvrage de Matthew B. Crawford, L’éloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail ou au documentaire de Jean-Robert Vialet, La mise à mort du travail en 2009 qui a cristallisé de nombreuses interrogations. C’est surtout de mal-être au travail et de « perte de sens du travail » (que l’on retrouve aussi dans les écrits du sociologue Richard Sennett) dont il est question, c’est-à-dire une forme ou une autre de l’idéologie nostalgique d’un « travail bien fait » et des « vrais gestes du métier ».
Pince-mi et pince-moi. Bourgeoisie et mouvement ouvrier dans le bateau de la critique du point de vue du travail
Mais le travail n’est pas seulement au cœur des plaintes pour ses contenus et conditions changeantes au cours de la trajectoire de production du capitalisme. De manière en apparence paradoxale, l’objet même de la plainte constitue, pour l’individu moderne, une vision du monde et un attachement subjectif tellement prégnants, qu’il est aussi le point de vue à partir duquel la plainte et la critique sont entreprises. Le travail se trouve toujours au cœur d’une critique et de récriminations faites du point de vue même du travail [9]. Cette critique qui cherche « l’émancipation du travail », est une critique faite d’un point de vue quasi naturel, c’est-à-dire du point de vue d’une ontologie. « C’est une critique, note Moishe Postone, de ce qui est artificiel au nom de la “vraie” nature de la société » [10]. Et son caractère est positif ; « son point de vue, poursuit Postone, est la structure déjà existante du travail et la classe qui travaille. L’émancipation se réalise lorsque la structure du travail déjà existante n’est plus entravée par les rapports capitalistes [réduits à de simples rapports de distribution] et utilisée pour satisfaire des intérêts particularistes, mais lorsqu’elle est soumise au contrôle conscient dans l’intérêt de tous » [11].
Les mécanismes complexes d’identification au travail (et ce dès l’enfance, sous la forme des injonctions socio-parentales du type « Quel métier tu voudras faire quand tu seras grand ? ») et la vision du monde social naturalisant le travail, s’ancrent dans la « seconde nature » des rapports sociaux capitalistes où chacun se rapporte objectivement aux autres, au travers du travail, et doit donc pour (sur)vivre se penser en permanence subjectivement sous la forme d’un sujet-prestataire de ce travail sous une forme ou une autre. L’individu n’existe qu’à travers ce qu’il a à vendre ou à acheter à partir de son travail. Ce sujet qui se pense et appréhende le monde du point de vue du travail n’est pourtant pas seulement celui qui sera dans une démarche anticapitaliste. Elle est plus largement le fait du sujet moderne quelles que soient les classes sociales auxquelles il appartient.
La première critique bourgeoise de l’aristocratie terrienne et des vagabonds jetés sur les routes par la décomposition des rapports féodaux, est ainsi faite du point de vue du travail. Comme l’a souligné l’historien des Annales Lucien Febvre, au moins depuis la fin du XVIe siècle, « le bourgeois laborieux de ce temps ne se dresse pas seulement, au nom de son labeur, contre l’oisiveté monacale – mais encore contre l’oisiveté nobiliaire » [12]. Dans cette critique, le travail est le critère de la valeur sociale. De Antoine de Montchrestien à John Locke, les bourgeois sur-éclairés des XVIIe et XVIIIe siècles critiquent ici du point de vue des groupes « réellement » productifs, les aristocrates sous-éclairés ou les autres formes prémodernes, en les qualifiant d’« improductifs », de « parasites » et d’« oisifs ». Tandis que la « formation de vastes groupes de misérables, écrit Bronislaw Geremek, inadaptés au travail industriel, fait partie du coût social de la naissance du capitalisme ». La bourgeoise se fait le bras armé d’une « répression [qui] frappe le chemineau, le fainéant, l’escroc, au nom de l’éthique du travail, pour les besoins du marché de la main d’œuvre » [13]. Ici l’implémentation du travail comme forme de vie sociale moderne se manifeste comme une intolérance répressive où la société moderne s’extirpant de sa peau féodale se sépare des « inutiles au monde » et « inutiles à la chose publique », « poids inutiles de la terre », tous ces gueux qui au nom d’arguments économiques, policiers et moralisants sont contenus par une « législation sanglante » (Marx) dans le processus de « renfermement des pauvres » (B. Geremek). On les chasse, on les fouette, on les marque, on les condamne, et en associant le charitable et la répression, on les enferme en Angleterre dans le Bridewell, des maisons de travail qui occupent dès le XVIe siècle les chômeurs. Ils seront les « coûts sociaux » de l’accumulation initiale du capital. Les « inutiles au monde » « sont non seulement rejetés du corps social mais semblent même être dépouillés de leur nature humaine »[14], celle du moins qui fait corps et esprit avec le travail.
Cette critique bourgeoise faite du point de vue du travail est très perceptible dans tous les mouvements d’indépendance qui marqueront les rébellions au temps de la première colonisation, comme déjà dans la « Grande révolution » française. Les motivations des pamphlétaires et rebelles américains lors de la guerre d’indépendance des États-Unis en sont un exemple caractéristique. Thomas Jefferson, John Adams, James Otis comme Samuel Adams, les pères de la révolution américaine, expriment une critique de la féodalité européenne et une opposition à la royauté britannique ‒ « le roi et ses parasites » dit Thomas Paine [15] ‒, du point de vue du sujet moderne du travail. Pour nos révolutionnaires américains, remarque Elise Marienstras, la « liberté consiste, lorsque les hommes le désirent, à corriger les effets du hasard, à quitter une terre pour en choisir une autre et, point crucial de la démonstration, à y acquérir des biens et à les faire fructifier. Jefferson, n’admet aucune limite au droit des colons à posséder sans entraves. […] James Otis avait […] souligné la différence entre la propriété qui découlerait d’un privilège (celui des chartes) et celle des colons individuels qui l’ont acquise “par l’entreprise et le labeur”. De même, Samuel Adams avait distingué entre la propriété qui résulte d’un don, et qu’il jugeait illégitime, et la propriété acquise par le travail. […] En Europe, explique encore Samuel Adams, la société est dominée par une caste dont le statut et la richesse ne tiennent pas au mérite des individus, tandis que les Américains ne peuvent compter que sur leur talent et leur travail » [16]. Deux mondes s’affrontent ainsi quand s’affirme l’idée que « c’est une loi de nature inaltérable qu’un homme doit avoir le libre usage et l’exclusive disposition, sans aucun contrôle, du fruit de son travail honnête » (Samuel Adams) [17]. Cette activité sociale générique et nouvelle est au cœur des valeurs bourgeoises jusque sur le terrain de l’éducation. Sous la IIIe République en France, on instruisait les enfants de la valeur du travail dans le célèbre Tour de France par deux enfants : « Voulez-vous mériter la confiance de ceux qui ne vous connaissent pas ? Travaillez. On estime toujours ceux qui travaillent » [18]. Et dans le même ouvrage : « Que chaque habitant et chaque province de la France travaillent, selon leurs forces, à la prospérité de la patrie » [19]. « Que de peines nous nous épargnerions les uns aux autres, si nous savions toujours nous entendre et nous associer dans le travail » [20]. Bruno admet volontiers que c’est le but de son ouvrage : « nous avons voulu présenter aux enfants la patrie sous ses traits les plus nobles, et la leur montrer grande par l’honneur, par le travail, par le respect religieux du devoir et de la justice ».
Depuis le début du XIXe siècle, la classe ouvrière s’est formée au travers d’un « processus actif, mis en œuvre par des agents tout autant que par des conditions » (Edward P. Thompson [21]), dans la sphère de la circulation où les « possesseurs de force de travail » vendent désormais aux « possesseurs de monnaie » leur « marchandise singulière » (Marx), comme dans la sphère de la production vivant l’expérience de l’exploitation et de n’être que les « masques de caractère » du rapport-capital. Comme la classe bourgeoise un siècle plus tôt, la classe ouvrière s’est à son tour consciemment identifiée au travail et a commencé à voir le lieu de travail comme une arène potentielle pour l’émancipation. Sa conscience critique, oppositionnelle et bientôt révolutionnaire, s’est installée à son tour dans le point de vue du travail en cherchant à chasser l’ancien occupant de ses murs, offrant à l’utopie du lieu de travail une carrière prometteuse ‒ sous les formes diverses de l’associationnisme, du mutuellisme, du collectivisme, du contrôle ouvrier, de l’autogestion, etc.
Ce processus d’intériorisation du travail, sous la forme d’une autodiscipline d’identification, surgit en France dans les années 1830 – on pourrait penser qu’en Angleterre, il correspond à la période que Joshua Clover appelle « la transition de l’émeute à la grève » entre 1790 et 1842 [22]. La parole ouvrière devient dès lors la « voix d’une intelligence qui est celle du principe nouveau : le travail »[23]. Une parole qui demande la reconnaissance de sa place au sein de la nouvelle forme de vie sociale corsetée par le « principe nouveau » : « ce ne sont point des grâces que nous réclamons, déclarent avant Proudhon les ouvriers tailleurs, nos droits et rien que nos droits »[24]. Ce « droit au travail » qui surgit en France en 1848, puis ce droit du travail, resteront le présupposé commun du mouvement ouvrier dans ses franges majoritaires. Ce processus vient à terme probablement dans les années 1850. Jean-Pierre Drevet, mécanicien parisien à cette époque, évoque au sujet des ouvriers de métiers en voie de prolétarisation, le fait qu’ils étaient déjà partagés entre l’amour du métier et la haine de l’exploitation. C’est cet état d’esprit écrit-il, qui pousse les ouvriers à « se révolter contre le travail qu’ils pourraient aimer »[25]. Cette critique paradoxale du point de vue du travail traversera tout le mouvement ouvrier et révolutionnaire, y compris des pans entiers de l’anarchisme. Un Michel Bakounine, comme tant d’autres, pouvait ainsi tomber en partie d’accord avec son ennemi le bourgeois en proclamant que « le jour où le travail musculaire et nerveux, manuel et intellectuel à la fois, sera considéré comme le plus grand honneur des hommes, comme le signe de leur virilité et de leur humanité, la société sera sauvée, mais ce jour n’arrivera pas tant que durera le règne de l’inégalité, tant que le droit d’héritage ne sera pas aboli » [26]. Les indications de Postone se vérifient une fois de plus, on critique bien un capitalisme qui est perçu comme « artificiel » – l’inégalité, le droit d’héritage, mais cela pourrait être le marché ou la propriété privée, ‒ « au nom de la “vraie” nature de la société », c’est-à-dire à partir d’une compréhension transhistorique du travail. Comme l’indique Kurz, le capitalisme est inlassablement réduit à de simples rapports de distribution répartissant les résultats d’un procès de travail qui lui est ontologisé et perçu comme simplement technique. Si ce collectivisme bakouninien même fédéraliste, défenseur au final du « salaire collectiviste » et baigné dans l’économisme, s’opposait au collectivisme autoritaire pour qui la production serait plus tard dirigée par l’État, il n’en partageait pas moins l’idée inscrite dans le marbre lors du congrès de Saint-Imier de l’AIT anti-autoritaire, qu’il faudra bel et bien « établir la société organisée sur le travail » [27]. On sait aussi quelles sont les premières phrases du Programme du Parti ouvrier allemand dit de Gotha en 1875 : « Le travail est la source de toute richesse et de toute civilisation » [28]. En cela, anarchistes, marxistes et bourgeois partageaient la même Religion du travail. Ce point de vue du travail qui constituera l’idéologie principale enracinée dans la lutte des classes n’est pas à critiquer parce qu’il mène une propagande pour la lutte sociale, mais parce qu’il reste capté, de manière anachronique, à l’intérieur de l’ontologie du travail, de la forme-valeur et du rapport de la valeur-dissociation relatif au genre ‒ car, comme pour les bourgeois, le travail sera identifié à la virilité du « mâle » mais cette fois-ci sous les traits des mains calleuses et des poitrines huileuses. Le réalisme socialiste partageait ici, avec l’esthétique bourgeoise, une même glorification de la production et des producteurs et finalement des Tours Eiffel de la technique [29]. Malgré leurs différences, note Michael Seidman dans Ouvriers contre le travail, « la théorie de la modernisation et le marxisme (y compris ses variantes anarchistes) ont une vision comparable de la soumission ouvrière au travail. En effet, on peut dire que la théorie de la modernisation a simplement prolongé le consensus sur le travail, dont était largement absente toute critique, que les marxistes et les anarchistes ont mis en place au XIXe siècle » [30].
Cette façon de voir fétichiste est quelque chose qui touche toute la société aux XIXe et XXe siècles, et pas seulement la droite qui fera du travail, on le sait, une de ses valeurs essentielles. Sa critique des « oisifs », des « assistés sociaux », des gens au RSA, des « travailleurs détachés » sera toujours exprimée du point de vue du travail. Même le racisme biologique peut s’armer dès le XIXe siècle, au nom du travail de la nation et de la « race supérieure », quand il s’agira de haïr ces immigrés italiens « voleurs de travail », quand d’autres durant ces dernières décennies seront accusés de venir en Europe pour « pour vivre des allocations du chômage ou familiales », autrement dit, vivre comme des « parasites » sur le dos de la communauté de travail nationale. C’est bien là du point de vue du travail que l’on projette la catégorie de « race » ou un ensemble de stéréotypes négatifs sur des populations, afin d’exclure celles-ci du travail et de sa communauté. Dans l’histoire du capitalisme, ce point de vue du travail peut être ainsi excluant comme incluant. Dans une première phase d’ascension du capitalisme ou durant les phases de croissance économique, le travail constituait le vecteur principal d’intégration au système producteur de marchandises, il s’agissait d’inclure tout le monde vaille que vaille, le patronat recherchant aussi cette main-d’œuvre étrangère peu chère. Ce point de vue du travail est incluant dès le XVIIe siècle dans la mise en workhouses des pauvres par l’État développementaliste anglais, et devient partout au XIXe siècle le creuset de la forme-nation capitaliste lors des modernisations de rattrapage quand il s’agit de rattraper le retard économique sur les nations-locomotives de tête du capitalisme. Dans une seconde phase, le travail devenait plutôt un privilège réservé à ceux qui étaient du bon côté de la barrière. Maintenant, il fallait éviter qu’ils viennent travailler. Ce point de vue du travail sous son prisme excluant est un des fondements du surgissement de la xénophobie (y compris spécifiquement ouvrière) et du racisme biologique dès la fin du XIXe siècle [31]. Généralement la bascule entre un point de vue du travail incluant et excluant suit les mouvements de crise et d’expansion de l’accumulation du capital.
Du temps où les luttes sociales n’étaient pas toujours favorables au travail
Les luttes sociales et la lutte des classes n’ont pas toujours pris la forme, au sein du mouvement ouvrier et de l’anarchisme, de ce « mouvement pour le travail » évoqué par le Manifeste contre le travail. La période de l’accumulation primitive, entre les XVe et XVIIIe siècles, qui voit surgir le mode de production et de vie capitaliste ‒ l’Économie ‒ est résumée par Arthur Rimbaud par cette formule taillée sur mesure : « Les blancs débarquent. Le canon ! Il faut […] s’habiller, travailler » [32] (Kurz ne se serait pas exprimé autrement pour identifier le rôle de la révolution des armes à feu dans la naissance de la socialisation moderne par le travail). L’ensemble des éléments de l’accumulation initiale du capital, en particulier la mise au travail des populations, l’expropriation, la généralisation de la propriété exclusive, l’enfermement des pauvres et des mendiants, la chasse aux sorcières, la répression des femmes et leur cantonnement dans la sphère privée et le foyer, le pressurage fiscal de la paysannerie par les États royaux qui commencent déjà à endosser certaines fonctions de « capitaliste collectif idéel » caractéristiques des États modernes, etc., furent à cette époque « inscrits dans les annales de l’humanité en caractères de sang et de feu » (Marx).
La monétarisation des rapports sociaux et la constitution progressive de la forme de synthèse sociale au travers du travail abstrait impliquent une restructuration des formes des protestations dans les populations agraires prémodernes. Dans une période de transition au capitalisme, face au nouveau cadre des rapports sociaux où la richesse sensible matérielle devient le porteur de la richesse abstraite capitaliste (la valeur), les révoltes frumentaires sont croissantes, mais elles ne sont pas encore encodées dans les formes sociales capitalistes, leur forme d’intérêt spécifique et leur lutte immanente, la lutte des classes. Pendant cette transition vers le capitalisme, de nombreuses luttes font preuve d’une hostilité au principe nouveau du travail qui prend des formes diverses telles que l’individualisme agraire dans les campagnes, la propriété exclusive qui érige murs et clôtures, l’interdiction progressive de l’accès aux forêts par ceux qui veulent s’en réserver l’usage exclusif, etc. Cette histoire de la résistance mondiale à l’émergence radicale de l’Économie, reste encore largement à écrire.
En opposition à des courants historiographiques notamment marxistes qui propageaient une vision spasmodique de l’histoire populaire, l’historien britannique Edward P. Thompson a toute sa vie voulu montrer que les actions populaires, désignées par les mots « émeutes », « rumeurs », « bruits », « crimes » ou « émotions » dans les sources judiciaires, ne pouvaient pas être réduites à des réactions instinctives provoquées par la faim et l’atavisme des « primitifs de la révolte » comme les désignera de manière condescendante Eric Hobsbawm. Pour Thompson, l’émeute rurale est aussi le vecteur d’une politique latente, d’une culture et d’une morale ordinaire fruit du bon sens des gens de peu. On réagit et on critique pendant cette période l’implémentation des rapports sociaux capitalistes ‒ par exemple la forme de l’appropriation exclusive des terres ‒, non pas du point de vue du travail qui n’a pas encore corseté les vies, mais du point de vue de la morale et des traditions coutumières prémodernes. L’enjeu est la défense non pas des rapports prémodernes féodaux-agraires en tant que tels, mais des droits collectifs coutumiers et des biens communaux contre une définition plus exclusive de la propriété ouvrant la voie à l’individualisme possessif caractéristique du mode de subjectivation capitaliste. Ici ce n’est pas du point de vue du travail que l’on proteste, ni du point de vue du monde féodal-agraire, « les hommes et les femmes dans la foule étaient animés par la croyance qu’ils défendaient des droits ou des coutumes traditionnels », écrit Thompson [33]. Ce sont des commoners (des communiers), usagers de l’exercice collectif des droits d’usage prémodernes et non des travailleurs qui se battent contre les premières formes du capitalisme. Ce point de vue coutumier de la protestation, c’est ce que Edward P. Thompson a théorisé comme relevant de l’« économie morale de la foule ». C’est ce type de révolte, à front renversé par rapport à la situation de la lutte des classes à partir du XIXe siècle, qui va dominer tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles dans les classes populaires, notamment paysannes, qui ne s’identifient pas encore, comme les élites bourgeoises et l’oligarchie whig en Angleterre qui les combattent, au travail.
L’absence d’une critique du point de vue du travail et le désintérêt pour le travail, s’observent dans certains mouvements populaires et ouvriers en particulier au XIXe siècle dans les aires « retardataires » de la modernisation capitaliste. On pense à l’Espagne, comme l’ont montré les Giménologues [34], où l’on observe une tension constante ‒ qui ne fut jamais véritablement tranchée dans le mouvement anarchiste espagnol ‒ entre une critique faite du point de vue du travail et une critique qui ne voulait pas renoncer à un certain mode de vie où le temps ne se réduisait pas à engendrer de l’argent. Cette tension apparaît dans le mouvement ouvrier naissant autour de la dispute fondamentale relative à la question de la répartition des biens produits dans une future société post-capitaliste : à chacun son travail ou à chacun selon ses besoins ? En Espagne cette tension prend la forme de l’opposition, à partir des années 1880, entre le collectivisme anarchiste d’inspiration bakouninienne et attaché aux Idées sur l’organisation sociale de James Guillaume (1876) et le communisme anarchiste (forme première du communisme libertaire qui fut adopté par la CNT en 1919) inspiré par les thèses de Pierre Kropotkine rassemblées en 1892 dans La conquête du pain. Au cours des décennies suivantes, ce conflit au sein de la CNT se transforme dans l’opposition entre la tendance plus syndicaliste représentée par Diego Abad de Santillán qui à partir de 1932 intègre de plus en plus les valeurs du travail, de l’usine, du productivisme et de l’industrialisation capitaliste, et la tendance issue du communisme anarchiste et défendue en particulier par Federico Urales, le communisme libertaire. Celle-ci constitue un communalisme rural fondé sur les luttes de quartiers et prône l’organisation de l’ensemble des activités à partir du lieu même où l’on vit. Comme le note Floréal M. Romero, en rappelant combien Murray Bookchin s’inscrit dans cet héritage, les comités de quartier, « fédérés entre eux, avec une culture imprégnée de liens directs et émotionnels, décideraient de leurs activités dans les usines, dans l’agriculture et les autres domaines économiques et sociaux, constituant ainsi la commune libre » [35]. Comme le nota le congrès de la CNT en mai 1936 à la veille de la Guerre d’Espagne où une tentative de synthèse fut élaborée, ces « deux manières d’interpréter le sens de la vie et les formes de l’économie post-révolutionnaire » s’affrontaient au sein de l’organisation [36]. Durant la guerre d’Espagne, à la différence de la première tendance qui se compromettra largement (voir Seidman, les Giménologues), la tendance du communalisme libertaire sera à l’origine en Aragon d’une expérience révolutionnaire inédite au XXe siècle, organisant pour près de 400 000 habitants, une province sans État en élaborant dans plusieurs centaines de collectivités agricoles, les structures de base de la première étape du communisme libertaire.
Certains groupes, auteurs et avant-gardes artistiques à l’intérieur du mouvement ouvrier ou à sa marge, feront également preuve d’hostilité envers le travail. Max Stirner perçoit le moment de bascule vers le capitalisme dans la première moitié du XIXe siècle et sera probablement le premier auteur à identifier l’effet de miroir que l’on retrouvera entre la critique bourgeoise et le mouvement ouvrier. Les frères ennemis placeront tous deux le travail comme valeur suprême, une activité naturalisée et prétendument transhistorique. « Quand le communiste voit en Toi l’homme, le frère fait remarquer Stirner, Tu ne le dois qu’au côté “dominical” de sa doctrine ; son côté “hebdomadaire” ne Te considère absolument pas comme un homme sans plus, mais comme un travailleur humain ou un homme travailleur. […] Si Tu étais “fainéant”, […] [le communiste] s’efforcerait de purifier cet “homme paresseux” de sa paresse et de t’amener à croire que le travail est “la destinée et la vocation” de l’homme » [37]. Dans une polémique avec Feuerbach, Stirner écrivait également : « Le travail que l’on tient pour une tâche de l’existence, une vocation de l’homme […]. C’est à lui que remonte l’illusion qu’il faut gagner son pain, qu’il est honteux d’en avoir sans rien faire pour l’obtenir : tel est l’orgueil du mérite. Le travail n’a en soi aucune valeur et ne fait en rien honneur à l’homme, pas plus que la vie inactive du lazzarone ne le déshonore. […] Mais le travail considéré comme un “honneur de l’homme”, comme sa “vocation” a rendu possible l’économie nationale, et c’est lui qui domine encore dans le saint socialisme » [38].
Dès qu’une partie du mouvement ouvrier se mit à revendiquer en France un « droit au travail » à la suite des évènements de 1848, ce « droit » ne fit jamais consensus. « Le droit au travail, c’est le droit de rester toujours l’esclave salarié. […] Le droit au travail c’est tout au plus un bagne industriel » s’écria également Pierre Kropotkine en 1892 [39]. Paul Lafargue, le gendre de Marx, de retour de l’Espagne prémoderne où il avait constaté une répugnance à l’égard du travail parmi la population, déclama dans son célèbre Le droit à la paresse, qu’une « étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. […] Cette folie est l’amour du travail ». Dans les franges marginales du mouvement ouvrier classique, et en opposition ouverte avec lui, certains, rares, ont ainsi refusé le « point de vue du travail » et la sur-identification avec celui-ci. En témoigne également l’écrivain français de tendance anarchiste Georges Darien :
Les pauvres croient aussi que le travail ennoblit, libère. La noblesse d’un mineur au fond de son puits, d’un mitron dans la boulangerie ou d’un terrassier dans une tranchée, les frappe d’admiration, les séduit. On leur a tant répété que l’outil est sacré qu’on a fini par les en convaincre. Le plus beau geste de l’homme est celui qui soulève un fardeau, agite un instrument, pensent-ils. « Moi, je travaille », déclarent-ils, avec une fierté douloureuse et lamentable. La qualité de bête de somme semble, à leurs yeux, rapprocher de l’idéal humain. Il ne faudrait pas aller leur dire que le travail n’ennoblit pas et ne libère point ; que l’être qui s’étiquette Travailleur restreint, par ce fait même, ses facultés et ses aspirations d’homme ; que, pour punir les voleurs et autres malfaiteurs et les forcer à rentrer en eux-mêmes, on les condamne au travail, on fait d’eux des ouvriers, Ils refuseraient de vous croire. Il y a, surtout, une conviction qui leur est chère : c’est que le travail, tel qu’il existe, est absolument nécessaire. On n’imagine pas une pareille sottise. La plus grande partie du labeur actuel est complètement inutile. […] La seule raison d’être du travail, du labeur animal, est donc de se diminuer lui-même jusqu’à suppression plus ou moins complète. En refusant de comprendre cette chose si simple, en s’obstinant à croire à la nécessité du travail dans ses conditions présentes et à l’utilité de sa glorification, les Pauvres font le jeu de leurs tyrans et perpétuent leur propre esclavage. […] [Le] capital n’est que la somme de tous les crimes que les pauvres laissent commettre contre eux. Ce capital, c’est le protectionnisme, les privilèges et les monopoles, les traquenards financiers, l’esclavage militaire, l’impôt meurtrier, surtout la superstition morale et religieuse. Pauvres, c’est la somme de toutes vos lâchetés. En résumé, le capital que vous redoutez est tout simplement le crédit que fait votre patience imbécile à ceux qui vous disent qu’ils ont des capitaux, qu’ils n’ont jamais [40].
Autour de son journal De Mocker, un groupe libertaire de jeunes hollandais, entre 1923 et 1928, développa à son tour des positions similaires [41] : « Le travail est le plus grand affront et la plus grande humiliation que l’humanité ait commis contre elle-même » ; « Le capitalisme existe par le travail des travailleurs, voilà pourquoi nous ne voulons pas être des travailleurs et pourquoi nous allons saboter le travail ». « Nous rendons les jeunes conscients du fait que le capitalisme existe par leur travail et qu’ils doivent donc lui refuser leur force de travail » ; « Quand nous cesserons de travailler, enfin la vie commencera pour nous. Le travail est l’ennemi de la vie. […] Quand l’homme deviendra conscient de la vie, il ne travaillera plus jamais ». Le groupe Mocker publia en 1924 sous la plume d’Hermann J. Schuurman un texte court mais saisissant, en opposition frontale avec l’absolutisme du travail du mouvement ouvrier qui depuis le début du XIXe siècle avait décidé de suivre la bourgeoisie en redéfinissant la domestication de l’individu en matériel humain de la valorisation pour en faire un « droit » et un principe futur positif de la société postcapitaliste. Le travail n’est pas un « droit » écrivait Schuurman, « Le travail est un crime ». Dans son ouvrage Ne travaillez jamais. La critique du travail en France de Charles Fourier à Guy Debord, Alastair Hemmens a retracé la longue histoire des auteurs francophones ayant porté une critique (essentiellement phénoménologique) au travail. On pense à la « guerre au travail » des surréalistes, au mot de Paul Eluard, contre « l’ordre facile et répugnant du travail », aux situationnistes, au surgissement d’une critique catégorielle du travail dans les années 1970 avec Jean-Marie Vincent : une critique non pas seulement de tel ou tel contenu ou forme prise par le travail mais du travail en tant que tel, du travail en tant que forme sociale (voir le chapitre 5 de Alastair Hemmens, Ne travaillez jamais) [42]. On pense encore, de l’autre côté du Rhin, à la méfiance que suscite la logique productiviste chez certains auteurs de l’École de Francfort. Adorno pouvait ainsi écrire que « si les êtres sans inhibitions ne sont pas les plus agréables ni même des plus libres, une société libérée de ses entraves pourrait bien se rappeler que les forces de production ne sont pas le dernier substrat de l’homme, mais représentent sa forme historique adaptée à la production de marchandises. Peut-être la société vraie se lassera-t-elle du développement [des forces productives] et – tout à sa liberté – laissera-t-elle des possibilités inédites au lieu de se précipiter sous l’effet de contraintes démentes vers des étoiles lointaines » [43].
Dans les années 1980-1990, le pouvoir heuristique du concept de travail abstrait va commencer à être thématisé par le théoricien Robert Kurz en Allemagne, l’historien nord-américain Moishe Postone aux États-Unis et le philosophe Jean-Marie Vincent en France. La distinction fondamentale entre une critique du travail purement phénoménologique, et donc « affirmative », et une critique catégorielle négative devient dès lors absolument essentielle. À la différence de la critique phénoménologique du travail, la critique catégorielle du travail « fonde son analyse des expressions phénoménologiques du travail au sein du capitalisme dans une critique de la catégorie elle-même » [44]. L’abandon d’une critique du point de vue du travail pour une critique catégorielle du travail dont témoigne la parution en 1999 du Manifeste contre le travail du groupe Krisis, pose une question pratico-subjective : les gens peuvent-ils s’attaquer à ce qui fait d’eux ce qu’ils sont dans la totalité sociale capitaliste-patriarcale, c’est-à-dire des travailleurs, des citoyens, des consommateurs, des administrés, des « hommes » et des « femmes » assignés à des rôles sociaux spécifiques ? Car pour aller au-delà de la simple redistribution de la valeur, des places, des genres et des luttes qui restent inscrites dans la logique du capitalisme-patriarcat, il faut que soit mises en jeu dans les luttes, dans la remise en cause de la forme de vie sociale que nous constituons, les conditions de la reproduction sociale, donc de notre propre reproduction en tant que travailleurs et consommateurs, en tant que citoyens et contribuables, en tant que « femmes » et « hommes » assignés à des rôles sociaux déterminés par la logique de la valeur et la dissociation, etc. Le capitalisme-patriarcat, ce que nous appelons le patriarcat producteur de marchandises (on pourrait dire tout autant modernité ou Économie), n’est pas quelque chose qui nous est extérieur, c’est nous. La révolution, ça se fait en s’attaquant – précisément – à ce qui fait qu’on est ce qu’on est. Toutes les formes d’action, mêmes les plus radicales, toutes les stratégies vides de contenu révolutionnaire réel, se heurtent à cette limite. La révolution ça se fait en s’attaquant, au travers de nous-mêmes, à la forme de vie sociale et à la forme-sujet que nous constituons et que nous intériorisons, en s’opposant à ceux – quels que soient les classes, les genres, les places, etc. qu’ils occupent – qui veulent à tout prix les conserver et s’accrocher à elles quoiqu’il en coûte. Ce rapport social de la valeur-dissociation, on ne le détruira qu’en entrant dans d’autres rapports sociaux.
Au-delà de l’ontologie du travail : Prolégomènes pour un chantier théorique, historiographique et anthropologique permanent
À plusieurs égards, cette critique catégorielle et négative du travail a été mise en chantier au sein des mouvances de la critique de la valeur et de la critique de la valeur-dissociation. La parution de Ne travaillez jamais. La critique du travail en France de Charles Fourier à Guy Debord d’Alastair Hemmens en 2019, puis la réédition augmentée cette année du Manifeste contre le travail, devaient s’accompagner, pensons-nous, d’un numéro entier de la revue Jaggernaut consacré à cette question.
Sans chercher ici à présenter la totalité des textes du présent numéro, nous y publions l’un des textes importants et incisifs de Robert Kurz à ce propos, « Postmarxisme et travail fétiche. De la contradiction historique dans la théorie marxienne », paru en 1995 dans la revue Krisis, qui met en cause toute l’histoire de la modernisation des cent dernières années et le rôle qu’y ont joué tous les marxismes attachés à l’ontologisation de la production et du travail. Nous reviendrons dans un numéro ultérieur sur le différend majeur existant entre les groupes allemands Krisis et Exit ! et plus largement dans le champ de la nouvelle critique marxienne de l’économie politique. Un différend entre le concept postonien de « travail abstrait » présenté dans l’œuvre maîtresse de Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale et le concept kurzien de « travail abstrait » élaboré dans La Substance du capital de Robert Kurz. Nous retrouverons des éléments de cette divergence dans le texte signé dans ce numéro par Norbert Trenkle du groupe Krisis, « Socialité non sociale. La contradiction entre individu et société comme question centrale d’une théorie sociale critique » qui se rattache au concept postonien. Dans les chapitres 5 et 15 de La Substance du capital, Kurz a présenté des éléments d’une critique du concept postonien de travail et a répondu aux accusations de « naturalisme » quant à son propre concept. D’autres pièces de cette discussion seront proposées dans de prochains numéros.
Au-delà de cette question fondamentale pour tout renouvellement de la critique de l’économie politique, le travail constitue probablement le plus contradictoire de tous les concepts marxistes. Robert Kurz dans La Substance du capital a montré comment Marx avait entretenu un raisonnement aporétique à propos du travail, quand il insistait sur le fait qu’avec l’abstraction « travail » nous aurions affaire à une conception « très ancienne » et « valable pour toutes les formes de société », tout en expliquant en même temps qu’il s’agirait d’une catégorie « tout aussi moderne que les rapports qui engendrent cette abstraction simple » [45]. « On ne peut venir à bout de ce raisonnement aporétique a fait remarquer Kurz, qu’en définissant la catégorie “travail” comme abstraction réelle – et du même coup comme strictement historique, moderne, capitaliste – et en abandonnant complètement l’ontologie du travail » [46].
Le premier des articles du sociologue portugais Nuno Machado présenté dans ce numéro ‒ « L’aporie du concept de travail chez Marx : une analyse chronologique » ‒, déploie cette critique de manière efficace et méthodique en prenant pour objet l’évolution de la notion marxienne de travail. L’auteur montre notamment que dans ses premiers travaux, Marx définit le travail, dans certains passages, de manière négative comme une forme d’activité inévitablement aliénée, propre à la modernité capitaliste. Cette position commence à changer dans les Manuscrits de 1857-1858 dits « Grundrisse », ouvrage dans lequel le travail est saisi de manière ambiguë, tantôt en tant que catégorie capitaliste, tantôt en tant que catégorie ontologique-transhistorique. Enfin, à partir de la Contribution à la critique de l’économie politique en 1859, Marx adopte une double conception du travail : travail concret et travail abstrait ; mais dans ce contexte, seul le caractère historique du travail abstrait est reconnu, tandis que le travail concret est assimilé à la forme matérielle de (re)production de toutes les sociétés humaines. Le but de Machado est de transcender ces apories inhérentes à l’œuvre de Marx et de proposer une compréhension cohérente du travail en tant que forme d’activité historiquement spécifique au seul capitalisme.
Après une période de féminisme déconstructionniste, les approches marxistes-matérialistes ont dominé le discours féministe ces dernières années depuis les crises de la fin des années 1990. Plus l’« effondrement de la modernisation » (Robert Kurz) est devenu apparent depuis, plus le pendule menace maintenant de basculer dans une vulgaire direction marxiste, a fait remarquer Roswitha Scholz. Cela devient plus évident dans le manifeste Le féminisme pour les 99% de Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya et Nancy Fraser paru récemment [47]. Ce manifeste « féministe » doit être critiqué notamment pour le fait que le rapport asymétrique entre les sexes, mais aussi le racisme, l’homophobie, etc., sont une fois de plus transformés en contradictions secondaires, comme ils l’étaient auparavant dans les concepts marxistes traditionnels et le « féminisme de lutte des classes ». Mais plus encore, il est également caractéristique d’une ontologisation du travail et de la production, autrement dit du concept positif de travail abstrait qu’a charrié plus largement l’ensemble des composantes du marxisme traditionnel. Cette ontologisation n’est pas sans lien avec le marxo-féminisme (Silvia Federici, Mariarosa Dalla Costa, etc.) et le féminisme matérialiste (Christine Delphy, etc.) qui à maints égards constituent un féminisme de recouvrement.
Ces féminismes partagent avec le marxisme traditionnel l’ensemble de ses présupposés et au premier chef le fait de considérer le « travail » comme essence générique par excellence et de rétroprojeter les catégories modernes bourgeoises telles que l’« économique », l’« économie », la « production », le « mode de production », etc., sur l’ensemble des sociétés d’autrefois ou d’ailleurs. Ils ont également pour trait caractéristique leur incapacité à saisir ce qui est assigné au « féminin » et aux femmes dans la modernité, autrement que comme un dérivé de ce qui se passe dans la sphère masculine du travail abstrait (la sphère de l’économie d’entreprise). On ne rend jamais compte, dans l’élaboratin du concept, du fonctionnement réel de la totalité brisée capitaliste-patriarcale, qui ravale réellement de manière spécifique et significative à des « choses privées », inférieures et donc invisibles, à un en dehors du travail, tout un ensemble d’activités, sentiments, dispositions, etc. assignés au « féminin » et aux femmes, et ce parce qu’ils n’ont pas l’inqualifiable qualité de produire de l’argent à partir de l’argent. Loin de saisir dans le concept le « dissocié » féminin dans cette spécificité comme le défend Roswitha Scholz [48], c’est-à-dire en évitant tout type de dérivation simple depuis le rapport-capital, il s’agit, pour le féminisme de recouvrement, de saisir le rapport asymétrique entre les genres par l’extension emphatique de la conceptualité marxiste positive telle qu’elle se trouve utilisée pour saisir la sphère masculine du travail abstrait.
Ce féminisme produit dès lors un concept très spécifique (et problématique) du lien entre patriarcat et capitalisme. On subsume le « féminin » dissocié et tout particulièrement l’activité domestique assignée aux femmes dans la modernité marchande, sous le concept ontologico-transhistorique de « travail ». Ce féminisme conduit paradoxalement à réifier ces activités dissociées, car toutes ces activités assignées à la « féminité » – que l’on saisit parfois de manière problématique comme « production de la vie » ‒ sont contraintes par ce féminisme de recouvrement de se concevoir à travers les catégories patriarcales façonnées pour la production de marchandises (il en va de même de la catégorie du « travail fantôme » chez Ivan Illich). Ce furent là toutes les limites du « débat sur le travail domestique » dans les années 1970, qui fut au travers d’une inflation du concept de travail qui n’était pas bien délimité théoriquement et de ses accents parfois ouvertement « pro-travail », une tentative de coupler un cadre androcentrique aux problématiques de genre. Les activités assignées aux femmes furent dès lors conçues comme « travail reproductif » ou « travail domestique » sur le modèle du « travail productif » socialement valorisé dans le marxisme traditionnel androcentrique, et par extension se trouvèrent recouvertes par les catégories et formes sociales en usage dans la sphère du travail abstrait assignée au masculin. Tout ce débat retournait inlassablement au même point de départ pointé déjà par Heidi Hartmann : « marxisme et féminisme étaient une seule et même chose, et cette chose était le marxisme ». Sur le plan politique, les activités domestiques assignées au féminin y étaient systématiquement hissées au même niveau que le travail afin de prouver leur valeur (économique et morale) et motiver une idéologie de légitimation qui permette de revendiquer la distribution d’une « valeur » pour les activités dissociées assignées aux femmes : ce qui prendra, par exemple, la forme de la revendication pour l’obtention du « salaire ménager » à partir des années 1970 (on retrouve là Silvia Federici, Louise Toupin, etc.). Tout ce recouvrement marxiste traditionnel du féminin dissocié, aboutira aux mêmes limites que le marxisme qui affirmera positivement le travail. Se fondant sur une compréhension transhistorique du travail, pour ce féminisme, le travail forme le point de vue à partir duquel la critique du patriarcat est finalement entreprise.
L’article de Álvaro Briales présenté dans ce numéro souligne le potentiel de dialogue que pourrait entretenir le courant de la critique de la valeur-dissociation‒ et les thèses de Roswitha Scholz en particulier ‒, avec ce que certaines féministes appellent « la contradiction entre capital et vie ». Ce texte soulève des questions et comporte certaines limites, notamment celle de rester dans le périmètre de l’anti-économisme de Karl Polanyi qui présuppose toujours l’existence d’une « substance économique » de manière ontologique-transhistorique. Par ailleurs, l’ontologie relationnelle de Donna Haraway et de la « toile de la vie » (que l’on retrouve également chez Jason W. Moore) n’est certainement pas assez mise en question par l’auteur. Malgré ces limites, Briales résume en partie les caractéristiques de base de la relation entre marxisme et féminisme, et tout particulièrement leur utilisation problématique du concept de travail, en particulier la confusion entre le travail comme activité et le travail comme rapport social. Il montre comment la critique de la valeur-dissociation entre en conflit avec certaines approches féministes ayant revendiqué l’élargissement du concept de travail en vue de la reconnaissance sociale des activités les plus féminisées. C’est un débat qui sera poursuivi sous des angles différents et plus critiques encore, dans de prochains numéros de la revue.
La critique catégorielle du capitalisme a également investi ces dernières années la question de la critique de la rétroprojection des catégories modernes, notamment dans l’ouvrage de Robert Kurz, Argent sans valeur. Comme il l’a soutenu, il est très douteux que nous puissions parler dans les sociétés non-modernes d’autrefois ou d’ailleurs, de « rapports de production » ou de « production » dans le sens de catégories déterminantes et susceptibles d’être isolées conceptuellement. Du fait évident que les gens ont toujours eu à produire leur nourriture ne s’ensuit pas automatiquement que cet état de choses soit pour eux décisif, et puisse contenir dans sa propre logique, une définition de leur société, de son fonctionnement et la clé de tous les autres moments de la vie. « C’est une légende moderne, fait-il observer, que de supposer que la production, ou, dans le sens moderne, le “travail”, a rempli la vie dans son ensemble depuis les premiers jours de l’humanité. Ce n’est que par la suite que son fardeau aurait été légèrement réduit au détriment de beaucoup d’efforts, avec le “développement des forces productives”, et que seule la glorieuse modernité du capital, grâce à la technique et à la science, a produit le potentiel d’un “temps libre” à une grande échelle. Marx ne suit qu’à moitié cette légende en ce qui concerne la prétendue pénibilité de la vie pré-moderne ; en même temps, il sait et dit que le fétiche-capital transforme tout le temps de vie de l’être humain en “temps de travail” à un niveau toujours plus élevé » [49]. En vérité, le simple fait qu’il existe une production de biens alimentaires dans les sociétés non-modernes, ne nous dit rien sur le caractère spécifique de la société en question, qui ne peut être expliquée que sur la base des formes du rapport avec la nature et des gens entre eux. Si toute la pré-modernité, y compris la période du paléolithique, ne connaissait pas de « rapports de production », au sens strict d’une logique séparée qui se subordonne tous les autres moments et se les assimile, on peut encore moins parler de rapports « économiques » correspondants.
Il est vrai que le mot oikonomia vient de l’antiquité grecque, et il signifie à cette époque quelque chose de complètement différent de la fin en soi de l’accroissement de l’argent en davantage d’argent, à savoir les règles et les « recettes » concrètes pour l’organisation de la famille, l’entretien de la maisonnée et les conseils aux enfants. Mais la définition que donnera Aristote de l’oikonomia est fausse en un autre sens, car, dans sa polémique avec Xénophon, sa distinction entre l’oikonomia fondée sur la satisfaction familiale des besoins et la multiplication prémoderne de l’argent, la chrématistique (qui n’est en rien identique au capitalisme dans ses déterminations), correspond au final à une vision artificialiste et erronée de la société et des rapports de parenté de l’époque. C’est une supercherie moderne de penser qu’en s’appuyant sur les définitions aristotélicienne et xénophonienne de l’oikonomia, l’étymologie et les définitions grecques puissent offrir à la catégorie d’économique un caractère ontologico-transhistorique [50]. À travers l’histoire, remarquait Reinhardt Koselleck, « les mots qui durent ne constituent pas un indice suffisant de la stabilité des réalités » [51]. Pour les Grecs, il s’agissait alors de savoir, entre autres choses, comment tailler les oliviers, traiter les esclaves, déterminer le meilleur moment de l’année pour faire des voyages sur la mer, etc. Cet assortiment imaginatif de réflexions et de conseils ne peut pas être appelé une « pensée économique », même si nous pouvons être tentés de le faire en chaussant les lunettes embuées de l’économisme moderne, et leurs propres « questions d’argent » apparaissent dans des contextes sociaux absolument étrangers à notre compréhension et à nos déterminations modernes. Cela s’applique à toutes les sociétés non-modernes d’autrefois et d’ailleurs.
La désontologisation des catégories économiques modernes liées à la seule formation sociale capitaliste implique, si l’on suit Koselleck, de « saisir la durée, le changement et la nouveauté des significations des mots, avant de les utiliser comme indices de contenus non exprimés » [52]. L’histoire de la langue comme l’histoire des concepts tout au long de leurs passages modifiés à travers parfois différentes époques et formations sociales et différents moments des rapports sociaux qui les constituent à chaque fois de manière spécifique, exige une critique de la transposition dans le passé d’expressions, de mots ou concepts actuellement utilisés dans la modernité, tout en faisant « la critique d’une histoire des idées considérées comme des entités constantes mais exprimées sous des formes historiques différentes, sans jamais changer fondamentalement » [53]. Dans la critique des sources, il faut toujours apprécier les mots comme les concepts dans les champs d’expérience spécifiques de la période socio-historique en question, et ce « en spécifiant la fonction politique et sociale des concepts et leurs usages particuliers aux différentes couches sociales, bref, en faisant en sorte que l’analyse synchronique aborde aussi la situation globale et temporelle » [54].
Pour ce qui est du « travail » et des autres catégories économiques modernes, Robert Kurz fait justement remarquer que « bon nombre de sociétés historiques, y compris celles que l’on qualifie de “grandes civilisations”, comme par exemple l’Égypte ancienne, sont dépourvues de catégorie englobant abstraitement toutes les formes d’activité. Et même dans les sociétés où il semble que l’on puisse repérer un tel nom générique (mais justement pas d’abstraction réelle), ce nom recouvre en fait un secteur d’activité très restreint et ne désigne jamais une universalité sociale de « l’activité en général”. Lorsque, relativement à ces sociétés, la lecture moderne persiste à employer le terme ‘‘travail”, elle commet un malencontreux anachronisme et à proprement parler une erreur de traduction (cela vaut d’ailleurs aussi pour d’autres catégories spécifiquement modernes allant de pair avec le rapport fétiche fondé sur la valorisation de la valeur : la politique, l’Etat, etc. » [55] Il poursuit en indiquant que « si l’abstraction “travail” comme concept s’appliquant à la société moderne est bien originaire de l’aire linguistique indo-européenne, elle dut en tout cas faire l’objet à un moment donné d’une complète redéfinition, puisque, dans toutes les langues de cette aire linguistique, “travail” désignait invariablement l’activité spécifique aux esclaves, aux subordonnés, aux personnes sous tutelle, etc. ; il ne s’agit donc pas en l’occurrence d’un terme générique subsumant dans la pensée les différents secteurs d’activité, mais d’une abstraction comme mise à l’écart de certaines classes d’hommes dans la société […], autrement dit précisément pas d’une universalité sociale, d’une catégorie de synthèse sociale comme dans l’ère moderne. » [56]
Á partir des années 1970, bon nombre d’anthropologues, théoriciens et historiens ont eux aussi commencé à mettre en cause l’ontologisation et l’utilisation des catégories économiques modernes pour comprendre les sociétés non-capitalistes. Ce débat, dont l’objet est de dégager l’anthropologie et l’histoire de la référence à l’économie politique (mais aussi de la philosophie politique et de ses catégories transhistoriques), est loin d’être terminé. Il a commencé au milieu du XXe siècle avec Karl Polanyi, le père de l’anthropologie économique substantiviste, dont le propos fut de critiquer l’« inversion de perspectives » projetant sur les sociétés passées ou d’ailleurs, les phénomènes économiques contemporains. « Il nous faut nous défaire de la notion bien enracinée selon laquelle l’économie est un terrain d’application de l’expérience dont les êtres humains ont nécessairement toujours été conscients, affirmait Polanyi à la barbe des économistes tant bourgeois que marxistes. Pour employer une métaphore, les faits économiques étaient à l’origine enchâssés dans des situations qui n’étaient pas elles-mêmes de nature économique, tout comme les fins et les moyens n’étaient pas essentiellement matériels. La cristallisation du concept d’économie fut une affaire de temps et d’histoire. » [57]
Les limites de l’anti-économisme polanyien sont pourtant déjà perceptibles dans cette citation et illustrent toutes ses ambiguïtés. Kurz a fait ainsi remarquer que c’est bel et bien la force de gravité de l’idéologie bourgeoise des Lumières qui explique le fait que Polanyi continue encore à parler ici de « faits économiques » de manière transhistorique. Ces limites commencèrent à être mises en évidence à partir des années 1970 et 1980 par Louis Dumont dans sa préface à La Grande transformation, par Jean Baudrillard, Gérald Berthoud, Michael Singleton et Serge Latouche, ou encore par le sociologue du travail proche de l’école de la régulation, Michel Freyssenet (1941-2020) récemment disparu, dans un texte important, « Invention, centralité et fin du travail »[58]. Progressivement, c’est la perspective polanyienne qui allait être reconnue comme un premier moment encore ambiguë de ce dégagement de la rétroprojection des catégories capitalistes modernes de l’économie politique. Ce dégagement pouvait « tourner court », selon le mot de Dumont. Polanyi mettait bel et bien en cause l’économie bourgeoise formaliste et le problème de sa rétroprojection, cependant l’économique en tant que, cette fois-ci, substance ontologico-transhistorique continuait de passer en douce. « Il devrait être évident, tempêta Louis Dumont, qu’il n’y a rien qui ressemble à une économie dans la réalité extérieure jusqu’au moment où nous construisons un tel objet ». Dumont pensait que Polanyi restait en-deça de Marcel Mauss qui avait déjà observé que « ce sont nos sociétés d’Occident qui ont, très récemment, fait de l’homme un ‘‘animal économique’’. Mais nous ne sommes pas encore tous des êtres de ce genre. [...] L’Homo œconomicus n’est pas derrière nous, il est devant nous » [59]. « Un spectre hante l’imaginaire révolutionnaire : c’est le phantasme de la production » notait encore Baudrillard en 1973 dans Le Miroir de la production ou l’illusion critique du matérialisme historique. Ce phantasme poursuit-il, « alimente partout un romantisme effréné de la productivité. La pensée critique du mode de production ne touche pas au principe de la production. Tous les concepts qui s’y articulent ne décrivent que la généalogie, dialectique et historique, des contenus de production, et laissent intacte la production comme forme. C’est cette forme même qui ressurgit idéalisée derrière la critique du mode de production » [60].
Durant l’après-guerre, des anthropologues et historiens issus la plupart du temps du marxisme traditionnel ‒ comme Maurice Godelier, Marshall Sahlins, Daniel Becquemont, Pierre Bonte, Philippe Descola, Alain Guerreau, etc.‒, sont partis généralement avec la grille du matérialisme historique en tête sur leur terrain anthropologique ou historiographique, pour en revenir complètement transformés. « Que ce soit moi-même, Claude Meillassoux, peu importe, évoque Maurice Godelier, on part tous avec le concept d’infrastructure et superstructure… mais je connaissais d’ailleurs mieux les textes qu’eux d’ailleurs, ayant tout lu Le Capital et presque tout Marx, vérifiant les traductions…, j’étais assez imbibé quand même, et on cherche tous à voir comme dans le matérialisme dialectique, s’il y a des relations de correspondance structurelle entre un système de production et un système de reproduction humaine qu’on appelle un système de parenté. On est partis, moi et les autres chacun de son côté, et on n’a pas trouvé. C’est beaucoup plus compliqué que ce que pouvait imaginer Marx » [61]. L’expérience se réitère chez Marshall Sahlins qui soutiendra finalement à partir de 1968 que « le travail n’est pas une catégorie réelle de l’économie tribale » [62]. Chez les Maenge de Nouvelle-Bretagne, l’anthropologue Michel Panoff remarque encore qu’« il n’existe pas de notion de “travail” comme telle, non plus que de mot distinct pour isoler les ‘‘activités productives’’ des autres comportements humains. Il ne faut s’attendre à découvrir ni célébration ni dépréciation du travail » [63]. « L’approche anthropologique ne permet pas […] d’esquiver une interrogation qui, note une spécialiste des mondes amérindiens Marie-Noëlle Chamoux, plus que toute autre, peut être lourde de conséquences théoriques et pratiques : peut-on dire que le travail existe quand il n’est ni pensé ni vécu comme tel ? » [64]. Ces mots font écho également au propos suivants du grand historien du Moyen Âge qu’est Jacques Le Goff : « Je crois aussi à l’importance de s’appuyer sur une philologie d’époque. Là où le mot n’existe pas, je pense que la chose qu’il est censé désigner, représenter, n’existe pas non plus. […] Bartolomé Clavero le démontre brillamment pour l’économie. J’estime qu’on pourrait aussi le faire avec profit pour le travail […]. Ne pouvons-nous échapper à une incapacité à reconnaître les hommes du passé comme autres ? Sommes-nous condamnés à l’anachronisme et à des prisons […] du présent et du contemporain ? Ne faudrait-il pas réfléchir sérieusement sur l’anachronisme qui procède […] d’une idéologie sous-jacente de l’histoire ? » [65]
Le matérialisme historique perdait beaucoup de terrain même dans la pensée critique de cette époque. Jean Baudrillard en 1973, notant que « c’est le concept de production qui tombe alors sous une critique radicale », poursuivait cette nouvelle charge, en cherchant à porter la critique au-delà du dégagement tronqué de l’économie politique moderne amorcé par l’école polanyienne – et dont Sahlins restait encore provisoirement le défenseur dans Âge de pierre, âge d’abondance avec son concept bancal de « mode de production domestique ». En 1976, Sahlins élaborera dans Au cœur des sociétés. Raison utilitaire et raison culturelle, une critique bien plus fondamentale, tant du matérialisme bourgeois, écologique que marxiste. De ce livre, Philippe Descola dira vouloir en « tirer la leçon », toute sa « conséquence logique » [66], ce qui déterminera l’écriture de Par-delà nature et culture. Un ouvrage qui va participer aussi de ce débat à propos d’une désontologisation des catégories modernes de « travail », de « production », de « mode de production », etc. et qui rejoint la critique catégorielle du capitalisme entamée par les courants de la critique de la valeur et de la critique de la valeur-dissociation. Un passage du livre de Descola mérite d’être cité longuement :
La position de Marx est indicative d’une tendance plus générale de la pensée moderne à privilégier la production comme l’élément déterminant des conditions matérielles de la vie sociale, comme la voie principale permettant aux humains de transformer la nature et, ce faisant, de se transformer eux-mêmes. Que l’on soit marxiste ou non, en effet, l’idée est devenue commune que l’histoire de l’humanité est avant tout fondée sur le dynamisme introduit par la succession des manières de produire des valeurs d’usage et des valeurs d’échange à partir des matériaux que l’environnement fournit. Or, il est légitime de se demander si cette prééminence accordée au processus d’objectivation productif est généralisable à toutes les sociétés. Certes, on a « produit » en tout lieu et en tout temps : partout les humains ont modifié ou façonné des substances de façon intentionnelle afin de se procurer des moyens d’existence, exerçant ainsi leur capacité à se comporter comme des agents qui imposent une forme et une finalité spécifiques à une matière indépendante d’eux-mêmes. Peut-on dire pour autant que l’on appréhende partout ce genre d’action selon le modèle de la relation au monde appelée « production », si paradigmatique et familière pour nous que nous avons pris coutume de l’employer pour qualifier des opérations hétérogènes dans des contextes très divers ? […] En tant que manière de concevoir une action sur le monde et un rapport spécifique d’engendrement entre le sujet et un objet, la production n’a donc rien d’universel. [C’est pourquoi les anthropologues sont peut-être imprudents lorsqu’ils cèdent à la facilité d’interpréter dans le langage familier de la production les phénomènes très divers au moyen desquels une réalité, matérielle ou non, en vient à être instituée. Parler de « production » […] hors du contexte occidental […] n’est au mieux, et dans la plupart des cas, qu’un abus de langage conduisant à des parallèles trompeurs [67].
Citons également l’ouvrage des anthropologues français Pierre Bonte et Daniel Becquemont dans Mythologies du travail. Le travail nommé :
Les hommes, en fait, dans la plupart des sociétés, n’agissent pas sur la « nature » aux fins de satisfaire des besoins positifs tels que se nourrir ou se vêtir, mais pour sceller des relations d’alliance avec des forces cosmiques ; la nourriture, la satisfaction des besoins, ne sont que des signes, des « retombées » bénéfiques témoignant de ces relations d’alliance qui inscrivent, dans les représentations comme dans la réalité sociale, les sociétés dans un certain ordre de l’univers. L’on ne saurait alors parler de « travail » dans ces sociétés sans projeter malhabilement notre propre catégorie de travail sur leur propre fonctionnement. […] En aucune circonstance les activités productives ne sont vécues, et encore moins conçues, comme une lutte des hommes contre la nature en vue de la transformer mais comme un rapport contractuel qui englobe aussi les morts et plusieurs personnages mythiques […]. Au Moyen Âge chrétien, les activités productives étaient conçues comme la conséquence, parfois condamnation, parfois heureuse compensation, du péché originel, de la Chute de l’Homme chassé du Paradis et condamné à la « peine » et à la mort. Et ce que nous appelons de nos jours « produit du travail », ‒ ou par un raccourci conceptuel tout à fait particulier à notre société, « travail » tout simplement ‒ était conçu comme fruit de la « bonté naturelle » de la Divinité à l’égard de sa créature. C’est dans le cadre d’une vision cosmologique du monde, accordant plus de place au « surnaturel » qu’au « naturel », à l’action des dieux qu’à l’action des hommes, et fondée sur un système généralisé de correspondances analogiques, que s’inscrivaient les activités humaines, qu’elles soient génésiques, productives, ou plus généralement sociales. Affirmer qu’il existe une notion universelle du « travail », dans toutes les sociétés humaines ou non […] ne permet pas de comprendre les conditions réelles d’exercice de ce « travail », en aucune d’entre elles. « L’action de l’homme sur la nature », dans le langage de notre société, est une expression qui ne dit rien des qualités particulières sous lesquelles cette action est organisée et représentée dans la diversité des sociétés humaines. Nous nous proposons de montrer que cette notion de « travail » sous forme d’activité matérielle régissant les relations entre « l’homme » et la « nature » est une figure produite par le mouvement des idées occidentales. […] Tout autant que de déconstruction, terme emprunté au post-modernisme ambiant, l’on pourrait parler d’une construction du concept de travail dans notre société [68].
Par de nombreux aspects, les historiens se sont interrogés sur le problème de la rétroprojection des catégories modernes. Pensons par exemple à Jean-Pierre Vernant, Moses I. Finley, Alain Guerreau ou Jérôme Baschet. L’historien médiéviste Robert Fossier dans Le travail au Moyen Âge qui débute par une relativisation de son objet, remarque que les individus modernes, à moins d’être chômeurs, « tous les autres sont des “travailleurs” : leur fonction est de produire un objet ou un enfant, car si l’homme est “au travail” à la sueur de son front, la femme est “en travail” quand elle va enfanter. La chose nous paraît si naturelle qu’après avoir édifié un droit du travail, nous sommes aujourd’hui convaincus que tout homme a droit au travail. Or les siècles médiévaux ont une vision inverse. L’oisiveté y est “sainte” ; c’est la “meilleure part” répond Jésus à Marthe qu’indispose l’inactivité de Marie. Quant au “travail”, le mot n’y existe même pas : le tripalium, connu de la basse Antiquité, est un appareil à trois pieds où placer le cheval que l’on ferre, puis une sorte de chevalet de torture, et son glissement sémantique (combien révélateur !) au sens de “travail”, pénible évidemment – dès le XIIe siècle – n’a triomphé qu’au XVIe siècle. Ce sera donc pure convenance de style si j’en use, comme tous les autres d’ailleurs » [69]. Le Goff va également s’inscrire dans cette critique de la rétroprojection des catégories économiques bourgeoises de la modernité pour montrer que dans le monde agraire chrétien prémoderne de l’Europe occidentale (et donc plus encore, dans les périodes précédentes), il n’y avait aucune sphère distincte ou même dominante, d’« économie », ni une pensée correspondante. Dans son ouvrage L’Argent et le Moyen Âge l’historien fait un pas de plus : « Cette absence de la notion médiévale d’argent doit être mise en corrélation avec l’absence non seulement d’un domaine économique spécifique, mais de thèses ou théories économiques, et les historiens qui attribuent une pensée économique à des théologiens scolastiques ou aux ordres mendiants, particulièrement aux Franciscains, commettent un anachronisme » [70]. Le Goff reprend le mot de l’anthropologue espagnol Bartolomé Clavero qui affirme sans équivoque pour le Moyen Âge : « l’économie n’existe pas » [71].
La confusion entre la « production alimentaire » ‒ ou au sens plus général la « reproduction » ‒ et l’« économie » au sens moderne, est un anachronisme caractéristique qui s’enracine précisément dans la rationalité des Lumières capitalistes. Dans ce numéro, nous présentons un deuxième article de Nuno Machado, « “L’invention du travail”. Historicité d’un concept chez André Gorz, Dominique Méda, Françoise Gollain et Serge Latouche » qui montre comment ces auteurs se sont affrontés à la question posée par le tournant de la spécification historique des catégories et des activités modernes. Après la publication de Adieux au Prolétariat, en 1980, l’auteur montre que la compréhension du travail, considéré historiquement comme une activité spécifique de la modernité capitaliste, est l’un des piliers de l’édification théorique construite par André Gorz. Le travail est intimement lié à l’apparition d’une sphère économique « désencastrée » du reste de la société. Dans cet article, Machado cherche à caractériser en détail l’évolution du concept de travail dans les œuvres principales de Gorz. Il compare ensuite cette notion sur l’historicité du travail avec les idées de trois auteurs francophones, à savoir Dominique Méda, Françoise Gollain et Serge Latouche. Il fait notamment un relevé analytique des ressemblances et des différences entre ces auteurs. Enfin, il fait remarquer qu’il est plus pertinent de comprendre les raisons évoquées pour expliquer le développement historique du travail dans le contexte embryonnaire commun de la « révolution militaire » des armes à feu du XVIe siècle qui a inauguré l’ère moderne dans le monde occidental.
Ce numéro ne constitue encore qu’une première pierre à l’approfondissement théorique, psychologique, historique et anthropologique de ce débat sur le caractère historique du travail, de la valeur, de la marchandise, de l’argent et du patriarcat spécifique de la forme-valeur (un ouvrage à paraître se penchera plus spécifiquement ce qu’il en est de l’État et de la sphère politique moderne). La traduction et la publication dans les prochaines années de l’ouvrage de Robert Kurz, Argent sans valeur, apportera également pour nous un pièce fondamentale à cet édifice, tant les questions historiographiques et conceptuelles y ont été renouvelées de fond en comble. Nous prolongerons très certainement cette discussion dans de prochains numéros, en abordant la question de l’histoire du capitalisme-patriarcat et de sa naissance, le rôle de l’argent, l’émergence historique du rapport de dissociation sexuelle, l’inclusion – ou non ‒ du fétichisme de la marchandise dans l’histoire des fétichismes qui se sont succédés dans l’histoire des sociétés humaines, ce qui nous conduira à dialoguer, comme nous l’avons annoncé dans le premier numéro, avec l’anthropologie culturelle, l’historiographie contemporaine, l’histoire des femmes et celle des concepts.
Clément Homs pour le comité de rédaction de Jaggernaut
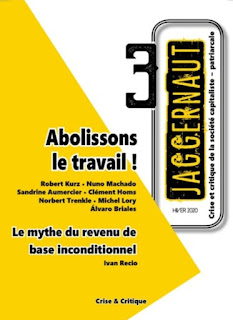






Commentaires
Enregistrer un commentaire